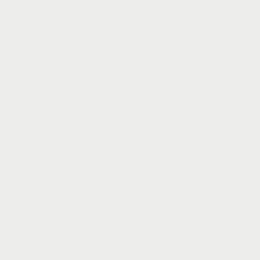
FR
Ib. Ibid. Ibidem
par Elora Weill-Engerer
« Nous rêvons de voyages à travers l’univers. L’univers n’est-il pas déjà en nous ? Nous ignorons les profondeurs de notre esprit. Le chemin mystérieux va vers l’intérieur. » *
* Novalis, Semences.
Œuvres philosophiques de Novalis, t.II, Paris, Allia, 2004,
Traduction : Olivier Schefer, p.72.
La peinture d’Eliot Shahmiri est tributaire des peintres historiques du paysage romantique : Carus, Friedrich, Constable, Turner en tout premier lieu. De leur pratique, l’artiste conserve, tout en l’assumant, la teneur poétique de l’invention, la dimension mystico-religieuse et l’articulation du réel et de l’idéal au sein d’une nature qui relève du symbole, soit exprimée en termes d’apparence visible et d’essence invisible. Dans leur laconisme, les paysages peints par Eliot Shahmiri convoquent une sémiotique propre au mysticisme exploré par ces théories romantiques : chaque élément est motivé à l’intérieur de la composition d’ensemble par une logique immanente. Le sens tient du rapport contenu dans le signe (signum) entre sa face signifiante (ce qui est montré) et le signifié (le concept, l’idée universelle). Un arbre mort, les pieds dans l’eau, ou un bois flotté à la dérive comme une Ophélie, contiennent autre chose que ce qu’ils laissent modestement à voir. Cette tendance à symboliser le paysage se retrouve dans la pureté et la simplicité des espaces peints par l’artiste, constitutives d’une typologie de la nature qui ne relève pour autant d’aucune volonté d’étude scientifique, car les biotopes choisis ne sont visiblement pas propices à la naissance d’arbres. Autrement dit, les lieux dépeuplés peuvent autant relever d’une vision rétro-futuriste que d’une considération écologique.
Le paysage existe d’abord à l’intérieur de soi avant d’être présent physiquement. C’est ce qui se retrouve dans la définition du paysage historique, où le « paysage » désigne une nature agencée selon l’imagination de l’artiste et non selon ce qu’il y a face à lui. Le sujet humble prend ainsi le pas sur la recherche de pittoresque pour proposer une vision frontale et anthropofuge, au sein de laquelle l’écocide prend l’allure d’un châtiment divin. La ligne d’horizon s’étire d’un bout à l’autre du tableau, sans qu’aucun détail pathétique ou superflu n’intercepte le regard : lande désolée, eau glauque, bande de terre nue ou plage crayeuse constituent des pans dépouillés qui se perdent dans l’immensité. Les confins du monde se déploient au-delà du cadre, permettant au regard de se suspendre librement, comme en flottaison. Cette tabula rasa accuse d’autant plus les uniques figures qui s’y dressent, ex nihilo, comme renaissant de leurs cendres. Les arbres décharnés tranchent l’horizon verticalement, opérant une médiation entre la force chthonienne et l’espace céleste qu’ils tutoient de leurs branches nues et pointues. Au coeur de cette nature étrangère et distante, leurs contours sombres et frêles matérialisent un tressaillement, comme un murmure sillonnant à travers le silence.
Dans le même temps, la dimension spirituelle du motif unique est mise en branle par une mécanique de la répétition systématique. La copie désacralise l’objet qu’elle dédouble comme un glitch informatique. Associée à l’imitation et à la reproduction, la copie serait antinomique à la pensée du génie artistique. La peinture peut-elle être répétée sans se vider de son effet ? « Ces copies seront éternelles, car leur type existe », dit une phrase que Goethe prête au Tasse. Evacuant la grâce de l’instant et le geste épiphanique, l’artiste expérimente, via le principe de répétition, l’idée d’une œuvre à résoudre, comme une équation. Il y a un plaisir à répéter ce que l’on croyait être de l’ordre de l’absolu. Le motif se re-présente littéralement aux yeux du spectateur c’est-à-dire, - en fonction du sens donné au préfixe « re » - : il se présente à nouveau (itératif) ou plus intensément (intensif). La répétition s’entend dès lors sur le mode de la résistance : l’objet se répète pour ne pas disparaître. Ce faisant, il se re-marque, en tant qu’il incarne un nouveau « type », pour reprendre le mot de Goethe.
Cette concomitance du symbole et de la mécanique permet peut-être de nuancer un antagonisme fréquemment répété : la mystique communément associée au paysage romantique historique ne s’oppose pas nécessairement aux innovations technologiques de la révolution industrielle. En se répétant, le motif se décline sur le mode de la translation. Dans le domaine de la géométrie, la translation évoque un glissement de l’objet, sans que celui-ci soit modifié. Dans le christianisme, ce terme désigne le déplacement des reliques depuis un lieu vers un autre. Ici, le glissement se traduit par la sérialité : il en va, chez Eliot Shahmiri, d’une énergie de la litanie. La peinture elle-même est en chiasme, procédant à un double parallélisme de construction. D’un côté, la duplication s’effectue horizontalement : le paysage se structure autour de deux plans, le ciel et le sol. De l’autre, la répétition se fait selon une symétrie axiale verticale, qui copie-colle le motif X fois. En résulte une peinture fondée sur un principe de gémellité poétique : l’arbre est lui-même un chromosome soumis à la division cellulaire, c’est-à-dire à une énergie vitale. Sur le mode d’une palingénésie encore à venir, cet arbre est sec, mais semble déjà prêt à bourgeonner.
Elora Weill-Engerer
Critique d’art membre de l’AICA
EN
Ib. Ibid. Ibidem
by Elora Weill-Engerer
"We dream of travels throughout the universe. Is not the universe within us? We do not know the depths of our spirit. The mysterious path leads within." *
* Novalis, Pollen and Fragments. Fragments N°2
Œuvres philosophiques de Novalis, t.II, Paris, Allia, 2004,
Translation : Olivier Schefer, p.72.